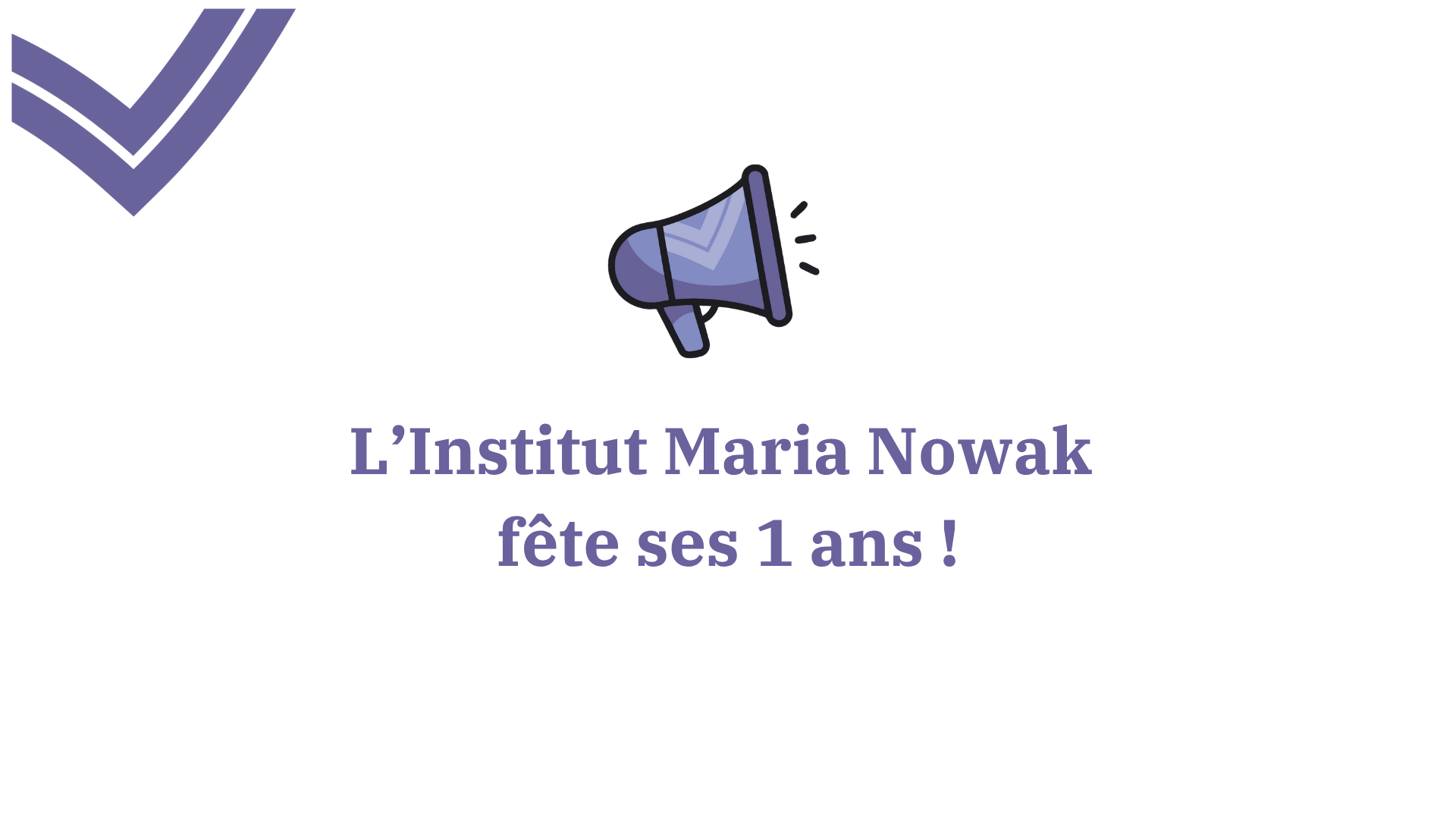Thierry Racaud
Ancien directeur des études de l’Adie

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Quel est votre parcours académique puis professionnel ?
Je suis titulaire d’une maîtrise en sciences économiques (Paris I) et d’un DESS en administration des entreprises (IAE de Paris). Mon parcours professionnel s’articule sur une quarantaine d’années autour des études marketing, socio-économiques et du conseil en marketing. J’ai débuté dans les études médias à la SOFRES et IPSOS puis au sein du groupe de presse professionnelle CEP Communication avant de rejoindre le Crédoc, où j’ai créé l’activité Études marketing. Mon expérience internationale s’est développée chez Research International et Added Value, où j’ai dirigé des études de grande ampleur et conseillé des marques leaders sur leurs marchés.
Enfin, désireux de rejoindre une structure à mission, j’ai intégré l’Adie en 2008 en tant que Directeur des études et du plaidoyer. J’y ai passé treize années, durant lesquelles j’ai développé des dispositifs d’évaluation de la performance sociale et des outils de mesure d’impact. J’ai également été membre du Conseil scientifique de l’Observatoire de l’inclusion bancaire de la Banque de France entre 2014 et 2020.
En tant qu’ancien directeur des études à l’Adie, quelles évolutions majeures avez-vous constatées dans le profil des bénéficiaires du microcrédit en France ?
En examinant les données sur séries longues, on ne peut qu’être frappé par la stabilité du profil des clients de l’Adie. Des critères importants, comme l’âge, le niveau de diplôme ou encore la proportion de chômeurs et d’allocataires du RSA indiquent une remarquable constance d’une année sur l’autre. Ceci s’interprète en particulier comme la capacité de l’Adie à rester fidèle à son public cible et révèle également la diversité de celui-ci, loin de constituer un bloc monolithique.
Cependant, certaines évolutions méritent d’être mentionnées.
- La part des femmes a augmenté, de 36% en 2007 à 44% en 2023. Cette croissance, bien que progressive, est significative sur une période de 15 ans.
- Une déformation, au sens statistique, de la structure sectorielle. En 2009, le commerce représentait 46% des activités, dont 25% pour le commerce ambulant. En 2023, il ne pèse plus que 25%, dont 8% pour le commerce ambulant. Cette baisse s’est principalement accompagnée d’une hausse des services (25% en 2009, 35% en 2023) et, dans une moindre mesure, des transports, boostés par les VTC (3% en 2009, 11% en 2023).
- Enfin, au-delà de l’Adie et de ses clients, l’émergence puis le développement très rapide du régime d’auto-entrepreneur ont bouleversé la structure des créations d’entreprises. Entre 2012 et 2023, les entreprises individuelles créées sous ce régime ont très largement entamé la part des entreprises individuelles dites “classiques”, comme l’a d’ailleurs mis en lumière la première publication produite par l’Institut Maria Nowak.
Quels enseignements avez-vous tirés de votre travail à l’Adie sur les conditions nécessaires à la réussite des entrepreneurs soutenus par le microcrédit ?
Des travaux menés à partir des données issues des études d’impact de l’Adie nous ont appris que les facteurs prédictifs de la réussite des créateurs ne dépendent guère de leurs caractéristiques sociodémographiques mais surtout de variables liées à la nature de l’activité elle-même, comme le choix du secteur. Celui-ci joue un rôle déterminant dans la pérennité des entreprises, un constat confirmé par les enquêtes nationales, notamment SINE, l’enquête de l’Insee sur les nouvelles entreprises.Par exemple, opérer dans le commerce réduit, au sens statistique, les chances de pérennité à 2 ou 3 ans.
L’autre grand facteur structurant, quoique de moindre importance, est l’expérience préalable des créateurs en tant qu’indépendants, laquelle joue logiquement un rôle important, mais pas déterminant, en faveur de la pérennité.
À l’opposé, les caractéristiques individuelles, comme le genre ou le niveau de diplôme, ont un impact beaucoup moins significatif. Nous avons utilisé une méthode permettant de neutraliser les effets de structure et de raisonner toutes choses égales par ailleurs. Ainsi, si l’on constate que les activité créées par des femmes ont une pérennité légèrement inférieure, cela s’explique principalement par leur surreprésentation dans le commerce, un secteur moins pérenne. Une fois ce type d’effets neutralisés, les différences sont minimes.
Avec votre expérience, constatez-vous un changement dans la perception de l’entrepreneuriat populaire et du microcrédit ?
Pour ce qui concerne l’entrepreneuriat, populaire ou non, oui indéniablement. Pendant mes années à l’Adie, j’ai observé une évolution vers une perception plus proche de la réalité. Progressivement, l’image de l’entrepreneuriat a changé. La vision traditionnelle de la création – le triptyque idée originale unique / mise de fonds initiale importante / objectifs de développement ambitieux – s’est estompée. On comprend mieux aujourd’hui qu’entreprendre c’est, peut-être avant tout, être indépendant. Le développement du numérique, des services et des dispositions légales simplifiant le processus de création ont joué un rôle clé dans cette évolution des mentalités.
Une évolution qu’explique aussi, au niveau sociétal, le renouvellement générationnel. La distinction entre effets d’âge et de génération considère, pour le dire simplement, que l’âge affecte nos opinions à différents stades de notre existence tandis que l’époque de notre naissance influence notre perception du monde. En l’espèce, je pense qu’il s’agit d’un effet de génération. On voit arriver sur le marché du travail une population qui ne s’attend plus à un parcours linéaire, soit le salariat soit la création d’entreprise, mais au contraire à des trajectoires plus fragmentées, avec éventuellement une coexistence de plusieurs activités, les fameux “slashers”. Ceci contribue à démystifier la création d’entreprise, perçue comme plus envisageable et accessible qu’auparavant.
S’agissant du microcrédit, les décideurs en matière de politiques publiques et les partenaires de l’Adie comprennent généralement bien son rôle, même s’il y a sans doute encore des progrès à faire au niveau des politiques. Auprès du grand public, le terme dispose d’une notoriété intéressante dont le contenu reste toutefois flou. Au demeurant, et quant à l’image portée par les médias et différents types d’experts, il semble que les représentations négatives du microcrédit, souvent non dénuées de composantes idéologiques et relativement fréquentes il y a une quinzaine d’années, se soient raréfiées.
Quelles sont les raisons / motivations qui vous ont poussé à rejoindre le comité scientifique de l’Institut Maria Nowak ?
J’y vois un prolongement de mon engagement à l’Adie. C’est aussi une forme d’hommage à Maria Nowak, avec qui j’ai travaillé étroitement pendant trois ans. À titre personnel, c’est une manière de rester lié à cette mission qui m’est chère. Et professionnellement, cela répond aussi au souhait d’établir une passerelle entre ceux qui disent et ceux qui font.
Je m’explique : durant mes années à l’Adie, j’ai fréquemment eu l’occasion de constater ce que j’appellerai un décalage voire parfois une dissonance entre praticiens et chercheurs. L’Institut Maria Nowak me semble être une opportunité de réunir ces deux mondes et de générer des synergies fructueuses. Dans cet esprit, la composition même du Comité, alliant universitaires et praticiens, me motive particulièrement. Je suis convaincu qu’un travail collectif efficace et structuré peut produire des résultats passionnants, concrets et actionnables.
Quels sont les projets ou initiatives de l’Institut qui vous enthousiasment particulièrement ?
L’ensemble des sujets évoqués retiennent mon attention, certains encore plus que d’autres. Par exemple, les dynamiques territoriales. On l’entend généralement aborder sur la base de l’écosystème local des entreprises : pas de délocalisation des activités, des clients et des fournisseurs ancrés dans la zone d’implantation de l’entreprise. La définition mériterait d’être à la fois précisée, affinée et le cas échéant élargie, de façon à jeter les bases d’une véritable évaluation de ces dynamiques dans le cadre de cette notion d’entrepreneuriat populaire.
Un autre point d’intérêt serait d’approfondir notre compréhension des facteurs de réussite et d’échec des entrepreneurs. En la matière, les études se concentrent surtout sur les taux de pérennité, voire à l’Adie le taux d’insertion ou le revenu. Une définition plus holistique de la réussite me paraît utile, en intégrant des notions relevant de l’empowerment en microfinance : l’épanouissement personnel, l’autonomisation, la fierté de soi…
Enfin, la question du rôle de l’accompagnement reste posée. Selon une idée couramment admise, c’est un facteur clé de la pérennité. Cette conception, qui gagnerait sans doute à être approfondie, occulte peut-être d’autres composantes importantes de son apport. Par exemple le fait d’être le catalyseur qui va contribuer à ce qu’un projet se transforme en entreprise.
Je suis cependant bien conscient qu’on ne peut pas tout faire dès la première année d’existence de l’Institut !
Comment la recherche de l’Institut Maria Nowak pourrait-elle aider les pouvoirs publics et les acteurs économiques privés à la prise de décision dans le domaine de l’entrepreneuriat populaire ?
Pour influencer les choix de ces acteurs de manière positive et durable, je pense que l’on peut faire une analogie avec le rôle des études marketing pour les entreprises : éclairer les choix stratégiques. Remplacez « lancement de produit » par « financement d’un programme de soutien à l’entrepreneuriat », c’est peu ou prou la même logique.
Pour être entendu, il faut s’appuyer sur quatre piliers :
- des travaux ancrés dans la réalité, loin des idées préconçues,
- des objectifs répondant aux préoccupations concrètes des parties prenantes, qu’il s’agisse de décideurs publics ou d’acteurs privés ; ceci n’interdit pas de mettre en lumière des thématiques essentielles sur lesquelles ces parties prenantes ne se seraient pas spontanément interrogées,
- une rigueur méthodologique irréprochable,
- une diffusion efficace des résultats et des préconisations qui en découlent.
Sur ce dernier point, je constate d’ailleurs que l’Adie a encore progressé et j’espère que l’Institut saura s’inscrire dans cette tendance.