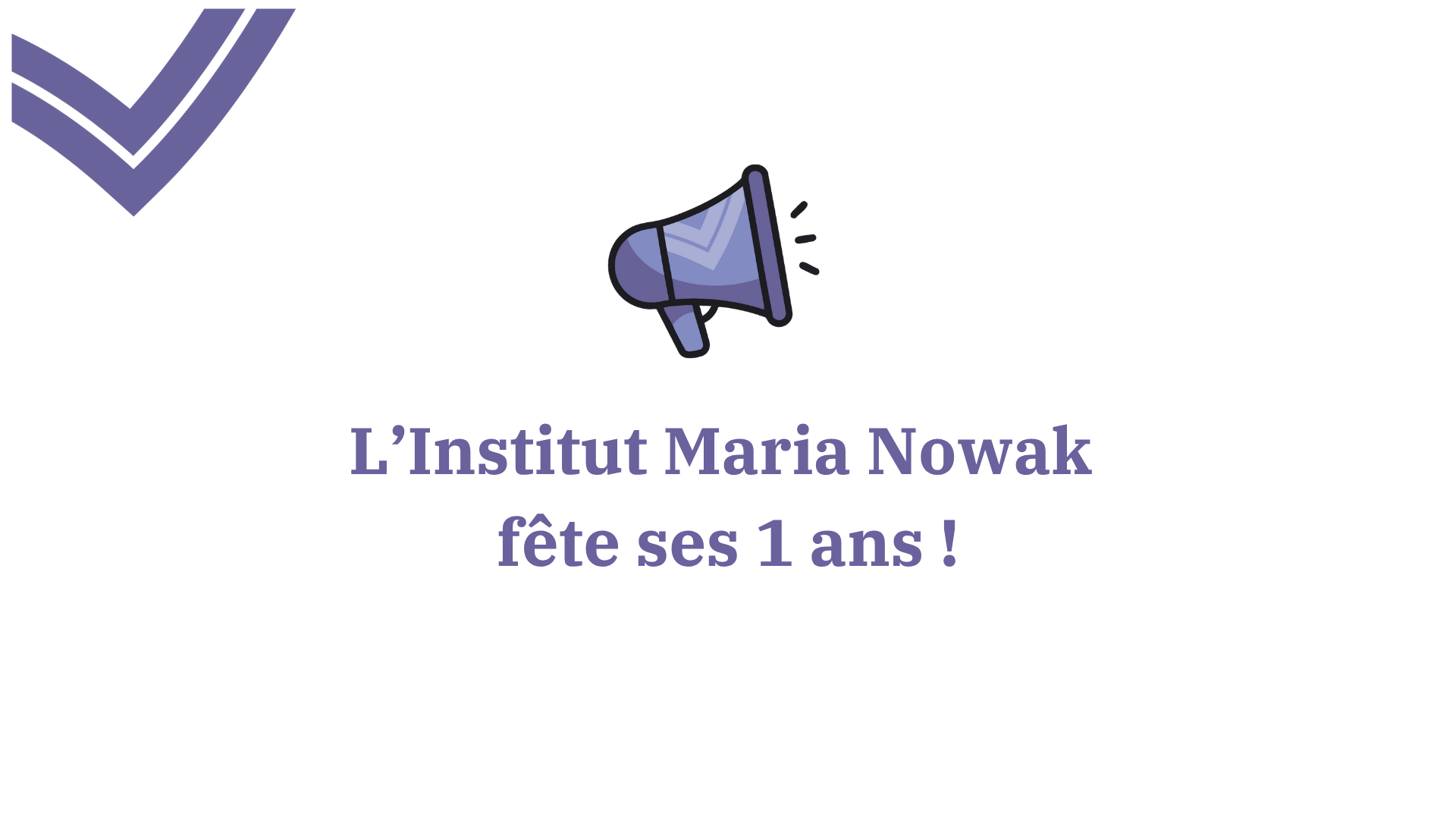Romain Slitine
Fondateur d’Odyssem et chercheur à l’IAE Paris 1 Panthéon – Sorbonne

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Quel est votre parcours académique puis professionnel ?
Je suis engagé depuis vingt ans dans les domaines de l’entrepreneuriat social et de l’économie sociale et solidaire. Mon parcours académique a débuté à Sciences Po, suivi par la Chaire d’Entrepreneuriat Social de l’ESSEC, fondée par Thierry Sibieude. Ces études m’ont permis de nourrir une conviction forte : l’entrepreneuriat, notamment social, est un levier puissant pour servir l’intérêt général et transformer la société.
Professionnellement, j’ai d’abord travaillé au sein du groupe Macif, où j’ai créé la direction de l’économie sociale. Ensuite, j’ai fondé ODYSSEM, une association dédiée à l’essaimage des bonnes idées d’innovations sociales. Nous y avons développé des projets d’entrepreneuriat collectif, comme Emergence en Franche-Comté ou REPLIC en Occitanie. Ces dispositifs rassemblent dès le départ des parties prenantes variées (porteurs de projet, financeurs, experts, collectivités locales) pour co-construire des entreprises sociales adaptées aux besoins des territoires.
En parallèle, j’ai écrit plusieurs ouvrages sur l’entrepreneuriat social, l’économie sociale et solidaire, et le financement des entreprises sociales. Ces travaux m’ont conduit à entamer une seconde phase de ma carrière axée sur la recherche. J’ai réalisé une thèse sur l’entrepreneuriat de territoire, explorant comment une démarche entrepreneuriale collective peut contribuer à une transformation durable des territoires.
Depuis cinq ans, je suis chercheur à l’IAE Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je travaille notamment sur le modèle du groupe Archer, une entreprise sociale basée à Romans-sur-Isère et Valence, qui se consacre à la création d’emplois durables sur son territoire. Archer est un exemple fascinant d’engagement entrepreneurial local et collectif, ayant relancé diverses activités, y compris dans des secteurs historiques comme la chaussure avec l’atelier « Made in Romans ».
En tant qu’enseignant chercheur sur les questions d’entrepreneuriat social et territorial à l’IAE de Paris-Sorbonne, quelles évolutions observez-vous dans l’intérêt des étudiants pour les innovations économiques et politiques ? Ces jeunes générations sont-elles porteuses de nouvelles formes d’entrepreneuriat ?
J’ai commencé à enseigner il y a longtemps, notamment à Sciences Po, où je continue toujours. Ce que j’observe particulièrement auprès des étudiants de Sciences Po, souvent plus jeunes, et dans mes différents enseignements à l’IAE, c’est que l’entrepreneuriat social, labellisé ainsi, devient mainstream.
Autrefois réservé à des étudiants militants ou particulièrement engagés, l’entrepreneuriat social est aujourd’hui une modalité d’entreprendre qui s’impose comme une évidence pour beaucoup. Cela ne signifie pas que tout le monde veut s’y lancer, mais c’est une option crédible, valorisée par les écoles, la société et même les familles. La recherche de sens qui pousse ces jeunes est socialement acceptée et portée, ce qui facilite leur engagement.
Cela dit, il reste des freins. Si l’intérêt est croissant, l’entrepreneuriat social demeure minoritaire. Des questions persistent : est-ce que je pourrai en vivre ? Suis-je aussi indépendant que dans l’entrepreneuriat classique ? Bien que ces doutes soient souvent infondés, ils freinent encore certains étudiants.
Quelles sont les raisons / motivations qui vous ont poussé à rejoindre le comité scientifique de l’Institut Maria Nowak ?
Ce qui m’intéresse profondément dans le projet de l’Institut Maria Nowak, c’est la notion d’entrepreneuriat populaire. Ce concept est encore peu étudié, en France comme à l’international, et je vois une opportunité majeure de le définir, de l’analyser et de l’inscrire dans un dialogue avec des approches comme l’entrepreneuriat social, de territoire ou durable.
Je suis convaincu que la recherche permet de mieux agir. Comme le disait Kurt Lewin, « il n’y a rien de plus pratique qu’une bonne théorie ». Je crois que théoriser l’entrepreneuriat populaire peut ouvrir de nouvelles perspectives d’action, tant pour l’Institut que pour des organisations comme l’Adie.
Quels sont les projets ou initiatives de l’Institut qui vous enthousiasment particulièrement ?
J’aimerais que nous réalisions des études collectives et des publications pour mieux faire connaître l’entrepreneuriat populaire. Une des questions qui m’intéresse particulièrement est la distinction entre entrepreneuriat individuel et collectif. Je pense que l’entrepreneuriat collectif est essentiel pour créer de la solidarité et démocratiser l’entrepreneuriat. Il s’agit également d’articuler cette approche avec une réflexion sur son impact social et environnemental.
L’Institut Maria Nowak a aussi un rôle clé à jouer dans la démocratisation de l’entrepreneuriat. Permettre à chacun, notamment aux plus précaires, d’accéder à cette autonomie et à cette responsabilisation qu’offre l’entrepreneuriat est une mission que je partage pleinement. Enfin, je suis passionné par la dimension démocratique de l’entrepreneuriat : comment renforcer la participation collective tout en rendant ce processus plus inclusif et solidaire ?
Vous avez beaucoup travaillé sur les innovations sociales et démocratiques. Selon vous, quels liens peut-on établir entre ces innovations et l’entrepreneuriat populaire ?
L’entrepreneuriat populaire est une forme d’autonomisation qui permet aux individus de reprendre le contrôle de leur destin, même à petite échelle. C’est une approche gratifiante, et je crois qu’elle a un rôle clé pour sortir des populations de la précarité.
Cependant, il faut aller au-delà de cette première étape. Une fois que les entrepreneurs ont surmonté leurs difficultés personnelles, il est important qu’ils réfléchissent à leur contribution à la société : aider d’autres entrepreneurs, intégrer des pratiques responsables, ou développer des projets à impact positif. C’est là que l’entrepreneuriat populaire rencontre l’entrepreneuriat social.
Un exemple inspirant est celui du groupe Archer, qui s’inscrit dans la dynamique “start-up de territoire”, qui mobilise des habitants pour imaginer et lancer des projets répondant à leurs besoins locaux, comme la consigne de verre ou l’agriculture durable. Ces initiatives montrent que l’entrepreneuriat populaire peut être à la fois local, collectif et porteur de transformations durables.
Quelles innovations sociales ou démocratiques vous semblent aujourd’hui les plus efficaces pour encourager un entrepreneuriat inclusif ? Voyez-vous des exemples inspirants en France ou à l’étranger – notamment en Algérie où vous avez pu travailler sur ces enjeux ?
En France, des dispositifs comme Emergence sont de bons exemples de soutien à l’entrepreneuriat collectif. À l’étranger, j’ai travaillé en Algérie sur des initiatives d’entrepreneuriat des jeunes. Malheureusement, l’approche y est souvent un contre-exemple : l’État tend à contrôler l’entrepreneuriat pour éviter des mouvements de contestation, ce qui limite fortement son potentiel.
Cela montre que l’environnement institutionnel est crucial pour encourager un entrepreneuriat inclusif. En France, il existe déjà des structures solides pour accompagner l’entrepreneuriat social et populaire, mais il faut continuer à les renforcer et à les orienter vers des démarches à impact.
Selon vous, le travail indépendant pour tous est-il une innovation qui pourrait contribuer à l’économie de proximité ?
Bien sûr, parce que l’entrepreneuriat populaire est, par définition, très souvent un entrepreneuriat local, qui crée de l’activité au plus près des territoires où vivent les gens et qui, dans la majorité des cas, est non délocalisable. C’est intrinsèquement un entrepreneuriat de proximité, un entrepreneuriat relationnel. Mais c’est également là qu’il faut s’interroger. Je pense qu’il y a un rôle clé pour l’Institut Maria Nowak et l’Adie dans l’orientation des entrepreneurs, en les incitant à réfléchir à leur impact sur la société et à leur contribution sociale. Cela donnera encore plus de sens à leurs projets entrepreneuriaux.